Race Traitor: The True Story of Canadian Intelligence’s Greatest Cover-Up
J’ai commencé le livre d’Elisa Hategan avec beaucoup de suspicions et pas parce que je ne crois pas au repentir ou parce qu’une ancienne néo-nazie pourrait ne plus l’être. Étonnement, ce doute planait strictement en raison du vocabulaire et de la syntaxe. J’avais la plate impression qu’on voulait m’en mettre plein la vue, voire me convaincre que j’avais affaire à un livre qui flirtait avec la littérature. Stricto sensu, ce n’est pas être un problème; trop peu d’auteur.e.s. aujourd’hui semblent muni.e.s. d’une plume pour chatouiller les méninges sur un plan autre que conceptuel, trop peu prêtent le flan aux caresses offertes par la poésie ou tentent d’envouter autrui par la création d’images détaillées, colorées. Peut-être que cet art trouvé, là où je ne l’attendais pas, m’a simplement déstabilisé, ce qui, avec le temps, s’est avéré une véritable bénédiction. Hategan se mérite l’heureux titre de conteuse hors pair, entre autres, parce que j’ai bingé son opus de 325 pages en deux jours, dont en une nuit un peu trop blanche à mon goût du lendemain, m'étant pourtant donné plus d’une semaine pour en venir à bout. Ainsi, ce qui devait être une incursion terrifiante dans l’histoire du Heritage Front – une incursion conséquemment entamée à reculons – s’est avérée une plongée dans une histoire qui vaudrait d’être franchement plus ou mieux médiatisée. Le témoignage de la jeune recrue possiblement dé-radicalisée en raison de son homosexualité, laquelle est vue dans ce type de milieu comme une tare passible de punitions, donne, certes, des frissons, mais aussi un éclairage sur le côté obscur de ce bon vieux Canada qu’elle n’est d’ailleurs pas la première à décrier. Combien de fois faudra-t-il crier, sans que ce soit précisément au loup, pour que les citoyens et citoyennes de ce territoire prennent conscience des tordages de cous et autres coups pendables des services secrets ? Encore faudrait-il que la plupart ait envie d’ouvrir un livre et fournisse l’effort pour apprendre, pour savoir, même si on peut d’ores et déjà dire que les pratiques du CSIS sont loin d’être nettes. On peut aussi en prendre connaissance en fouillant sur l’épisode des jeunes ayant voulu quitter le pays pour se rendre en Turquie afin de rejoindre l’état islamique (Voir le livre du journaliste montréalais Fabrice de Pierrebourg, Bye-Bye maman! Carnet d’ados radicalisés, paru aux éditions La Presse en 2017). Cela dit, les déboires du groupe de suprématistes blancs ayant déjà été assez médiatisés aux alentours de 1993-94, je peux plus ou moins vendre le punch de la publication d’Incognito Press, mais ne m’aventurerais pas à répéter, maladroitement, les faits scandaleux si bien relatés. Je m’engage néanmoins à ajouter un grain de sel, notamment, sur la place des femmes dans pareille organisation et ce qu’a pu en laisser entendre l’autrice en 1994.
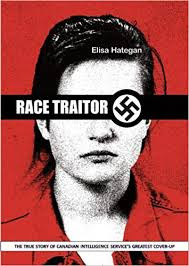
Des personnages fémininsHormis l’auteure avec laquelle l’incursion au cœur du nœud de vipères qu’est ce groupe fomenté en partie par les services secrets canadiens se réalise, une pléthore de figures féminines nous sont présentés. Je m’en suis réjouis, bien qu’à diverses occasions, ces dernières se trouvaient belles et bien dernières ou derrières l’impressionnante roumaine. « « La seule fille qui bottait des culs » (p. xx), mais se sentait néanmoins comme « un morceau de viande ». À croire qu’on ne sort pas de sa condition aussi facilement ou simplement parce qu’on nous offre la possibilité de briller dans les assemblées ou d’être un visage « vendeur » de la cause, parce précisément innocent. Pour paraphraser celle qui nous laisse entendre à une ou deux reprises que son père était juif et qui reproduit les diluviennes paroles professées à son endroit pour bien la ‘dompter » … Cela dit, Elisse qui est devenue Elisa, ainsi que Nina, Emma et j’en passe entre temps, nous plonge dans un univers unisexe sans trop attendre; univers qui ne se trouve quand même pas à être un « safe space », car c’est une prison de femmes. La jeune, voulant bien faire ou voulant surtout se sauver de cette spirale s’enfonçant dans les souterrains malsains, voire irrespirables de la haine où les agirs le moindrement déviants sont mal vus, a informé ledit camp adverse des intentions de la taupe et se trouve encore plus creux dans la spirale, pas nécessairement dans l’œil de la tempête, là où on raconte qu’il n’y a rien, mais accusée de crime haineux, une rareté à l’époque dans notre beau pays blanc et rouge Coast to Coast…Quoi qu’il en soit, cette entrée en matière ressemble à un prétexte pour nous parle d’une fouille à nue qui n’a pas lieu, la petite brune-rousse n’assumant toujours pas très bien ni son corps ni sa sexualité et encore moins le fait qu’une grosse femme gantée lui introduise ses doigts dans les orifices. Puis, c’est la figure maternelle qui fait son apparition. Si au départ, il n’est pas clair qu’elle est une harpie de la pire espèce, bien qu’on comprenne que sans des comportements douteux, Hategan n’aurait jamais croisé la route de Karen, une de ses rares personnes méritant le titre d’amie et qui était, de surcroit jamaïcaine (il faut quand même le dire, compte tenu des positions racistes exposées par la suite) en famille d’accueil ou d’écueils…à la manière où les faits d’armes de celles qu’elle a fréquentée soulèvent maintes questions. Or, arrive un point où cette mère, raciste et violente, peut être un moindre mal, le sang justifiant plus que les chèques les accrocs relationnels. Au troisième chapitre, bellement nommé, « The Family », on rencontre ceux et surtout celles qui forment le paysage blafard du Parkway, tout aussi bellement nommé. Parmi ces gens qui deviennent étonnamment si importants si rapidement, Nicolas Polinuk et Donna Elliot, deux femmes beaucoup plus âgées qui sont tout ce qu’il y a de plus normal. D’ailleurs, la première va bien faire comprendre à sa nouvelle émule qu’elle n’a pas de haine, mais de l’amour pour les siens, qu’elle n’est pas une nazie puisqu’elle n’a pas le look et qu’il est vraiment important de se mettre en couple hétérosexuel, et ce, sans plus attendre. Les activités considérées « de filles » – manger de la lasagne, s’occuper des enfants, rester à la maison, se teindre les cheveux, parler des garçons, boire du vin – ont lieu dans cette adolescence charcutée grâce à deux « vieilles », les initiatrices de la vie. Ce que l’abandon parental peut provoquer! Notre spitfire (tête chaude, voire brûlée, soupe au lait ou encore boule de feu et tigresse) ne semble jamais tout avaler sans questions, sans soupçons. On sent qu’avec le recul, l’histoire a pu se réécrire, à moins que ne soit que la traversée du miroir qui donne le ton, pour ne pas dire le tain…Il n’en demeure pas moins que certains intitulés, par exemple : « Boys will be boys » – un passage qui raconte une rencontre du KKK aux États-Unis réunissant toutefois une multitude de groupuscules, et la façon dont non seulement les femmes sont relégués aux cuisines et dans leur rôle traditionnel de matrices, mais les hommes s’achètent des armes à feu, tâte les cuisses sans consentement et se trouvent ben drôles – et « Reality Check » – les neuf pages qui vont de l’homophobie à la première rencontre de ce type dans les rues de Toronto et bouleverse notre narratrice. On apprendra plus tard que Pereta fut le premier amour dans les rues de Bucarest, que malgré l’innocence de l’enfance, la bien-aimée a mangé une osti de volée devant les yeux de l’autre, alors paralysée, n’ayant pas besoin d’être retenue à deux mains – ou l’étant métaphoriquement par la peur – après avoir profité du contact mutuel de leurs mains. Je souligne ces chapitres 14 et 17, puisque je considère qu’ils sont hautement instructifs sur les rôles genrés, sur la représentation des hommes et des femmes que la droite perpétue. C’est dorénavant bien connu que les femmes sont souvent des accessoires dans cette mouvance idéologique, Hategan parlant souvent des « petites amies » des gars qui sont précisément « ternes » si elles n’ont tout simplement que l’apparence de souris (à cause de la coupe de cheveux), tout en étant simplement les versions féminines des skinheads qu’elles accompagnent, petites choses qui s’ajoutent à leurs bottes et leurs vestes. La famille ne cesse de s’agrandir et c’est effectivement sur ce modèle que l’organisation, nécessairement hiérarchique, se déploie. Les femmes sont souvent les conjointes des énergumènes, quand elles ne sont pas de vieilles affaires rescapées d’une Europe de l’Est négationniste ou les mères et grand-mères – matriarches jouant parfois des rôles de premiers plans dans cette fresque de moins en moins drôle à fréquenter. Les cloches sonnent à différentes reprises, mais les fusils font plus de bruits, de même que la propagande délirante qui sort de celui qui la fera travailler comme une petite folle sans dédommagement, à part peut-être manger et je ne veux parler que de nourriture terrestre. Arrive quand même le basculement – le deuxième si on obéit aux discours dominants sur la radicalisation, même si ce basculement ne se fait pas dans un claquement de doigts – et s’en trouve soulagée. L’ironie du sort est toute visible, toute en noire sur le fond crème du bouquin, car c’est une des victimes des projets grandiloquents de l’agent double qu’elle a tenté d’avertir auparavant qui la sortira de ce qui ressemble, alors, bel et bien, à un enfer. La suite se déroule avec une ribambelle autrement impressionnante de Ruth, Annetta, Roxanne, Joyce, Mary, Pamela. Soudain, quand la conscience et le dire se noue, ce qu’on appelle plus communément un coming out, les garçons s’évaporent un peu dans la brume. Pas qu’ils ne sont plus là quand vient le temps d’aider, au contraire, c’est que le récit donne une nette impression de salvation par les femmes, même si Martin fait manifestement des pieds et des mains. Dans les dernières pages, le contraste est tel entre l’amour qu’elle leur porte à elles ou à eux qu’on se dit que l’amour saphique entache peut-être la vision de la traitre à la race.
Un féminisme potentiel?
Si les notes personnelles de la fin peuvent déranger, elles n’en sont pas moins indispensables pour saisir la complexité d’un parcours de radicalisation et déradicalisation, deux thèmes aujourd’hui forts à la mode même s’ils existent depuis la nuit des temps, pour voir les nombreuses couches que recèle généralement un individu. N’importe quel individu. C’est par ailleurs instructif et plutôt satisfaisant de voir qui se trouvent justement en dernière lignes, qui a de l’amour pour les siens ou qui peut être considéré de la sorte…Il est bien évidemment que les adeptes de théories du complot montrent plus de tics nerveux liés à leur infinie suspicion, ce qu’en jargon populaire ou dans les alcôves psys on appelle la confiance – d’abord en soi, bien évidemment, puis aux autres. Pour le dire autrement, ils sont plus susceptibles d’être blessés, atteints, mis en danger juste à cause de leurs idées…mot que j’emploie par la force des choses mais qui me répugne dans le cas présent, trop peu à propos pour identifier ce dont je veux parler…Peut-être faut-il invariablement parler dans ces cas d’opinions? Quoi qu’il en soit, l’extrême droite fait un retour en force de ci de là depuis quelques années. Les suprémacistes blancs de l’acabit du groupe foireux de Grant Bristow s’agitent beaucoup, se présentant comme des victimes qui ont besoin d’un retour à la tradition, à l’ordre et de mesures contre l’immigration. Généralement tous conscients de son caractère raciste, xénophobe et antisémite, nous ignorons souvent son visage fondamentalement sexiste. Traditionnellement, Hategan nous le fait bien voir, l’extrême droite réduit les relations entre hommes et femmes à une simple complémentarité et considère que le mouvement de libération des femmes est une anomalie. Une femme « sensée » doit adopter les soi-disant valeurs viriles et accepter la fonction de transmission du patrimoine biologique et culturel. C’est ainsi qu’elles peuvent s’engager dans la bataille identitaire, laquelle devient nativiste, car elles sont des êtres faibles qui doivent être protégés; on le voit d’ailleurs très bien quand la petite d’Heritage Front veut apprendre à manier les armes et à se battre – il semble que son entraineur soit révulsé et trouve cette demande terriblement inadéquate – menaçante peut-être – et préfère, pour ces raisons/déraisons la battre. Cela dit, on constate depuis quelques années, soit après 1991-1994, une présence plus visible des femmes dans les mouvements d’extrême droite dans de nombreux pays, jouant des rôles différents. On peut penser à des chefs de partis, comme Marine Le Pen en France et Anke van Dermeersen en Belgique, mais aussi à des influenceuses en ligne, comme Lana Lokteff, ladite lipstick fasciste sur YouTube. Est-ce à dire que ces femmes ne partagent pas toutes les idées véhiculées par l’extrême droite, y compris son sexisme inhérent ? Est-ce à dire que les femmes dans ce mouvement savent tirer avantage des faiblesses inhérentes aux mouvements, soit avoir incessamment besoin de renvoyer une autre image et de devoir se tourner vers les femmes pour ce faire ? Est-ce à dire que les femmes sont instrumentalisées ou qu’elles sont gagnantes ? Qu’en est-il de celles qui ne sont pas dirigeantes, oratrices, influenceuses ? Peut-on parler d’un féminisme et/ou de féministes de droite ?
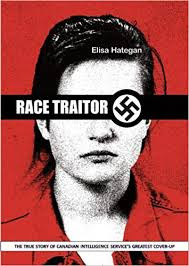


Commentaires
Enregistrer un commentaire